




L’éducation pour tous en Afrique : un slogan pour qui ?
Le problème de l’échec répété de la perspective d’une Éducation pour tous (EPT) en Afrique est posé dans cet extrait d’une communication au Séminaire Mondial sur l’Éducation de Porto Alegre, Brésil, le 31. 01. 2002. Trois axes de réponses sont proposés : d’abord sur l’identité commune des choix éducatifs de l’Afrique tels que définis à Johannesburg en 1999 et à Dakar en 2000 ; ensuite sur une lecture syndicale, objective et critique de ces discours officiels sur l’EPT; enfin, sur l’avenir de l’école en Afrique.
Déjà dans les années 1960, la communauté internationale espérait faire de l’année 1980, l’année d’une éducation accordée à tous les enfants du monde en âge d’aller à l’école. C’était à Addis Abbéba, en Ethiopie… Un nouvel espoir naquit en 1990 à Jomtien en Thaïlande, quand la communauté internationale jura que l’an 2000 aurait vu, dans tous les pays, la réalisation de l’Éducation pour tous ! L’Afrique reprit confiance. Mais là encore, ce fut un autre rendez-vous manqué : le dénuement, le délabrement et la pénurie chronique en tout ont continué à caractériser les systèmes éducatifs en Afrique.
L’EDUCATION POUR LA RENAISSANCE AFRICAINE
Du 6 au 10 décembre 1999
à Johannesburg, les Ministres de l’Éducation, les représentants de
la société civile et les organismes de développement international se
sont retrouvés pour faire le bilan de Jomtien et préparer Dakar 2000.
Le document final produit se voulait un Cadre d’action pour l’Afrique
subsaharienne dans le cas de l’Éducation Pour Tous. Il avait pour
sous-titre : " L’Éducation pour la Renaissance de l’Afrique
au XXIe siècle ".
Il s’agissait de " relancer le processus de rénovation des
systèmes éducatifs africains pour relever avec succès les défis du XXIe
siècle ".
Faisant le bilan de Jomtien, le document précise que seuls quelques dix
pays ont atteint l’enseignement primaire universel. Entre 1990 et
1998, le taux net de scolarisation des garçons a progressé de 9 %, s’établissant
à 56 %, et celui des filles de 7 % pour se situer à 48 % pour l’ensemble
de l’Afrique subsaharienne.
Des progrès qui se font avec des disparités. Par exemple, dans les pays
de l’Océan Indien, les taux (garçons et filles) atteignent 70 % ;
en Afrique de l’Est aussi, (hormis la Somalie), on a noté des progrès
de 60 %. Sur les 41 millions d’enfants en âge scolaire qui ne sont
pas scolarisés, 56 % sont de sexe féminin.
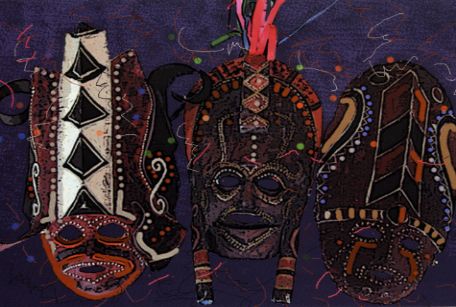
Les Ministres reconnaissent
que les abandons scolaires se sont aussi aggravés, en raison de l’augmentation
des coûts de l’école et des nombreux conflits armés. S’y ajoute
le fait que la " qualité de l’enseignement reste médiocre,
et les programmes scolaires sont souvent éloignés des besoins des apprenants
".
Les Ministres s’étaient engagés à " supprimer tous les obstacles
(d’ordre social, culturel, économique, politique et juridique) qui
empêchent les enfants, les jeunes et les adultes africains d’avoir
accès à une éducation de qualité ", et avaient reconnu que le
développement des systèmes d’éducation sur le continent " doit
reposer sur les systèmes de connaissance, les langues et les valeurs locaux,
etc. "
Les Ministres avaient mis l’accent sur " la nouvelle vision
d’une Renaissance africaine " qui n’est pas un retour
nostalgique au précolonialisme, mais un objectif pour une Afrique "
resplendissante dans la diversité de ses cultures, d’une Afrique
ayant remporté sa lutte pour la libération de l’esprit ".
Dans le but de faire de cette vision une réalité, les Ministres envisageaient
de renforcer l’unité africaine et la promotion de la Renaissance
africaine. Définissant dans ce cadre, des domaines prioritaires d’action,
les Ministres ont souligné la nécessité : d’améliorer l’accès
et l’égalité en accordant un intérêt accru aux enfants de la rue,
en développant des stratégies d’éducation non formelles pour atteindre
les enfants et les adultes défavorisés ; d’améliorer la qualité et
la pertinence de l’éducation en révisant les programmes scolaires
et les méthodes d’enseignement, en promouvant l’utilisation
de la langue maternelle dans l’éducation ; de renforcer les capacités
institutionnelles et professionnelles en créant un contexte politique
propice pour offrir à tous une éducation de base, en impliquant les syndicats
d’enseignants et les enseignants dans l’amélioration de la profession.
Sur la base de ces objectifs généraux constituant le Cadre général d’action,
les Ministres ont convenu que chaque équipe nationale aurait défini des
stratégies…
La réunion des Ministres s’acheva sur l’affirmation du rôle
de l’éducation comme " moyen stratégique pour parvenir à
la renaissance de l’Afrique ".
L’EDUCATION
POUR TOUS :
TENIR NOS ENGAGEMENTS RESPECTIFS
En Avril 2000 (du 26 au 28)
à Dakar, un autre Cadre d’action est adopté par la communauté internationale.
Les participants expriment leur détermination commune pour que "
les buts et objectifs de l’éducation pour tous soient réalisés
de façon durable ".
Jomtien est rappelé dans ses principes et dans ses engagements, et les
participants réaffirment leur fidélité à ses conclusions. Ils notent cependant
que, dix ans après, 113 millions d’enfants restent exclus de l’enseignement
primaire, 800 millions d’adultes sont toujours analphabètes, et que
la discrimination sexuelle continue dans les systèmes éducatifs. À partir
de ces constats, le Forum de Dakar s’est engagé à : développer la
protection et l’éducation de la petite enfance ; assurer en 2015
l’accès à l’Éducation de qualité pour tous ; améliorer de 50
% les niveaux d’alphabétisation des adultes ; abolir les discriminations
entre les sexes…
Pour atteindre ces objectifs, les gouvernements, organisations, institutions,
groupes et associations représentés ont retenu opportun de susciter un
puissant " mouvement politique en faveur de l’éducation pour
tous ", aussi bien au niveau national qu’au plan international.
Dans l’Éducation, un investissement supérieur est nécessaire afin
d’assurer le suivi et l’évaluation des décisions, ainsi que
pour " améliorer la condition, la motivation et le professionnalisme
des enseignants "…
Après Dakar, le Comité de rédaction du Forum Mondial a établi un "
Commentaire élargi sur le Cadre d’action de Dakar ".
Il a pu noter que, si l’aide internationale à l’éducation de
base a augmenté dans les années 90, le total de l’aide au développement
a baissé dans l’ensemble. Et le Comité d’indiquer les risques
d’une marginalisation croissante des pays d’Afrique privés d’accès
à l’éducation de base, dans une économie mondiale de plus en plus
articulée autour du savoir.
La date de 2015 est soulignée pour rappeler que c’est une obligation
pour tous les états d’" offrir un enseignement primaire gratuit
et obligatoire conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant
". Ce qui signifie que tous les obstacles (frais de scolarité, repas
scolaires, fournitures et autres frais) doivent être réduits pour inciter,
par de telles mesures sociales, tous les enfants à mener à terme l’enseignement
primaire.
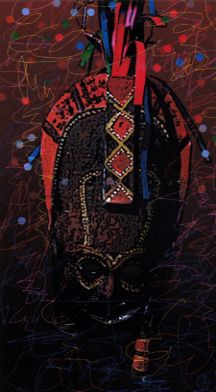
LECTURE SYNDICALE DE CES DISCOURS SUR L’EDUCATION EN AFRIQUE
Il est clair que les rencontres
internationales sur l’Éducation ont le mérite de reconnaître que
l’École ne marche pas, que les enseignants sont dévalorisés. Elles
prouvent tout aussi clairement l’échec des politiques éducatives
jusqu’ici mises sur pied en Afrique.
Que ce soit le Cadre d’action pour l’Afrique Subsaharienne renaissante
ou celui du Forum de Dakar, les recommandations sont les mêmes : une école
qui assure le développement de l’Afrique reste à réaliser. D’ailleurs
le titre du Rapport du Forum de Dakar est suffisamment éloquent : "
L’éducation pour tous : tenir nos engagements collectifs "
! …
Rappelons la situation précaire dans laquelle versent bon nombre d’enseignants,
à cause de salaires inadéquats, de leur surexploitation, de leur formation
insuffisante. À cela s’ajoutent les effectifs pléthoriques (des moyennes
de 100 à 150 élèves par classe), la pénurie en matériels didactiques (un
livre pour sept à neuf élèves), etc.
On a bien souvent l’impression que tout se passe comme si en Afrique
on considérait que l’éducation consiste simplement à accueillir des
jeunes dans des écoles par des aînés qui jouent à être des maîtres d’école.
Malgré tout, des bailleurs comme la Banque Mondiale considèrent que l’urgence
n’est pas de former des enseignants dans des écoles appropriées,
pour des durées longues et régulières, avec des salaires décents, mais
plutôt la " lutte contre le Sida qui mine les efforts "
déjà réalisés, qui tue massivement les enseignants africains, qui réduit
les naissances…
La priorité du Sida doit aller de pair avec la ‘surpriorité’
de l’éducation de qualité…
EN CONCLUSION : UNE AUTRE ECOLE EST POSSIBLE…
L’activisme actuel des
pouvoirs politiques en Afrique autour du " Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique " n’aboutira nulle
part si le pari d’une autre école n’est pas formulé, assumé
et gagné. Or, pour gagner ce pari, l’expression d’une volonté
politique conséquente est indispensable.
Cette autre école est possible. Elle s’appuiera sur une autre société,
une société libre, démocratique, soucieuse de justice et épanouie, dans
laquelle un nouveau type d’homme et de femme va émerger : un homme
et une femme équilibrés, tolérants, engagés dans l’action pour le
progrès social, économique, scientifique et culturel, un homme et une
femme critiques et autocritiques, ouverts vers des apports extérieurs,
mais aussi, profondément enracinés dans leurs propres valeurs de civilisation.
Cette autre école fera des cultures et des langues africaines son socle,
utilisera les nouvelles technologies non pas comme des outils marchands,
mais comme des instruments privilégiés pour trouver des réponses adéquates
aux interrogations de la vie. L’école sera ainsi une institution
crédible pour promouvoir l’émancipation de la personne et la justice
sociale.
Les moyens pour bâtir cette nouvelle école proviendront de l’affirmation
concrète de la souveraineté des États, qui accroîtront ainsi les budgets
nationaux, solliciteront une aide internationale non contraignante, exigeront
l’annulation de la dette et la réduction des dépenses militaires
et ceux de pur prestige.
Il reste que le moyen le plus sûr pour l’avènement de la nouvelle
école en Afrique demeure la détermination des enseignantes et des enseignants
à résister contre la jungle néolibérale, à se battre pour la dignité de
leur profession et pour un avenir décent pour eux-mêmes, pour leurs enfants
et pour les peuples d’Afrique.
Iba Ndiaje Diadji
Professeur à l'université C. A. Diop de Dakar.
Secrétaire Général du Syndicat Unique et Démocratique des Enseignants
du Sénégal
(SUDES)
